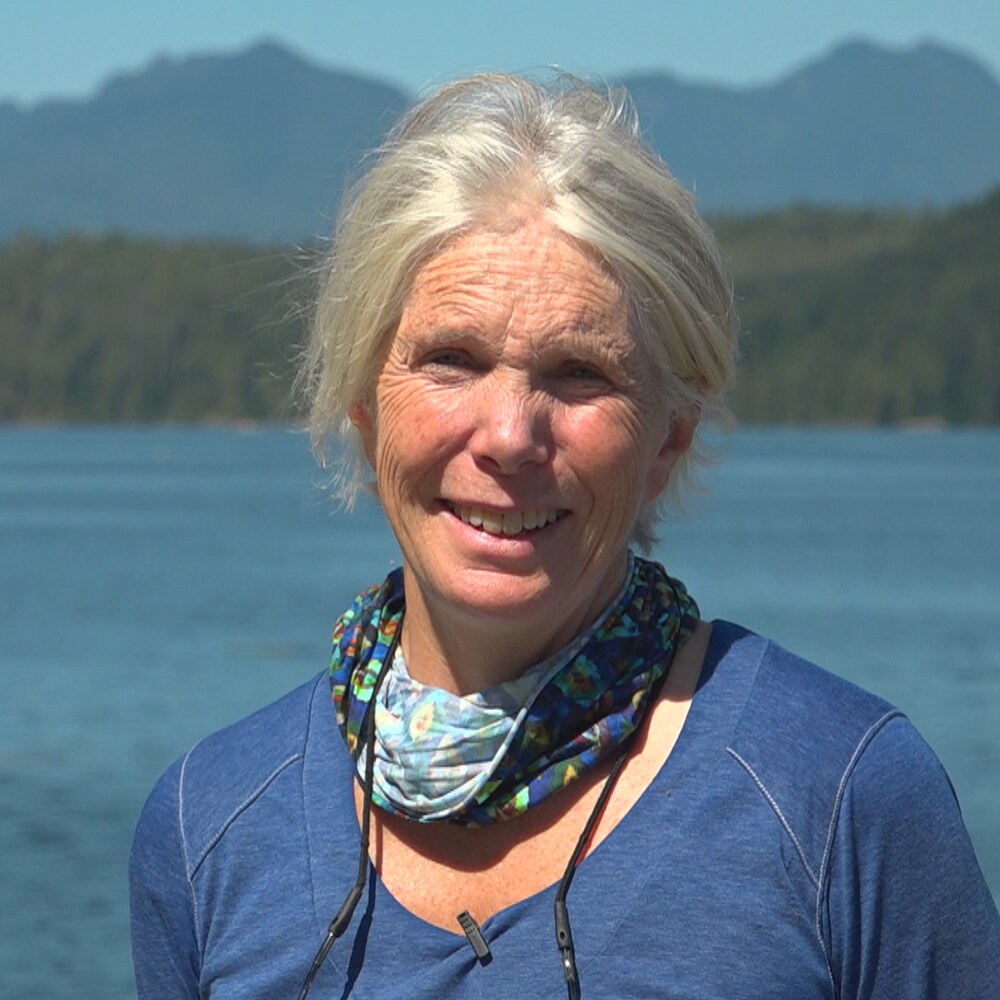Au large des côtes de la Colombie-Britannique, la loutre de mer, jadis disparue, fait un retour en force depuis les dernières années. L’histoire de ce mammifère nous renseigne sur l'importance des liens et des interactions entre les êtres qui vivent dans un même écosystème. C'est une réussite remarquable de réintroduction d'une espèce, mais qui ne se fait pas sans inquiétude.
Le retour « trop » réussi de la loutre de mer
Le retour « trop » réussi de la loutre de mer
Texte et photos : Benoît Livernoche

Au petit matin, au quai de Tofino, ville touristique de l'île de Vancouver, Linda Nichol et Erin Foster, deux biologistes marines, partent en mer pour une mission bien spéciale : compter les loutres de mer.
Nous évaluons la taille, la répartition et l'augmentation de la population
, affirme Linda Nichol, qui fait ce travail depuis plus de 20 ans pour Pêches et Océans Canada. Si on estime la population de loutres de mer aujourd'hui à environ 8000 individus, le nombre de loutres ne cesse d'augmenter depuis les dernières décennies.
Lorsque j'ai commencé mes recherches sur la loutre, il y en avait environ 3000
, précise Linda Nichol, qui veut nous expliquer à quel point la croissance de la population est importante. Selon ses recherches, la population de loutres de mer croît environ de 5 % à 6 % par an au large de la Colombie-Britannique.
Les loutres de mer font partie des rares animaux à avoir été décimés puis réintroduits. Et on en voit le résultat aujourd'hui
, ajoute pour sa part Erin Foster. Ce sont des animaux très résilients. Ces femelles avec leurs petits qui flottent sur la mer. Elles sont là 24 heures sur 24, tous les jours, dans toutes les conditions, grosses vagues, vents froids ou tempêtes
, observe quant à elle Linda Nichol.

Une histoire difficileUne histoire difficile
La loutre de mer était jadis présente partout sur le pourtour du Pacifique, du Japon à l'Alaska, de la Colombie-Britannique jusqu'au Mexique. Mais l'arrivée des Européens à la fin du 18e siècle bouleverse leur aire de distribution. À cette époque, la loutre de mer est lourdement chassée pour sa fourrure, qui valait une fortune sur les marchés de l'époque.
C’est en 1930 que la dernière loutre a été tuée sur la côte canadienne, selon Andrew Trites, qui dirige l'unité de recherche sur les mammifères marins à Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver. La population de la loutre de mer a presque complètement été décimée le long des côtes de l'Amérique du Nord. Seuls quelques spécimens se sont réfugiés dans des baies très isolées de l'Alaska.
Mais ce n'est pas la fin pour les loutres. Durant les années 1960, alors que les États-Unis procèdent à des essais nucléaires en Alaska, un mouvement de protection de ce qui restait des loutres voit le jour. L'un des points marquants survient lors des essais à l'île d'Amchitka, au bout de l'archipel des Aléoutiennes, en Alaska.
Comme ils allaient détruire l'île, cela allait tuer les loutres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les sauver? Est ainsi venue l'idée de transporter des loutres de là-bas et de les réintégrer dans les eaux côtières de l'île de Vancouver
, nous raconte Andrew Trites. Entre 1968 et 1972, il y a eu trois essais de réintroduction de loutres au large de l'île de Vancouver. En tout, 89 animaux ont été réintroduits.
Depuis ce moment, la population de loutres de mer n'a cessé de croître. Nous n'avions pas à gérer cette population ni à créer de programme de reproduction. Une fois les loutres de mer relâchées, tout s'est fait naturellement
, explique la biologiste Linda Nichol.
Il y avait donc des tonnes de nourriture!
, poursuit de son côté Erin Foster, qui explique que les loutres revenaient dans un habitat où elles avaient déjà existé, mais 200 ans auparavant.

Un bienfait pour l’écosystèmeUn bienfait pour l’écosystème
La loutre de mer est considérée comme un prédateur important. Comme elle est carnivore, sa présence est essentielle dans l'environnement. Le fait que les animaux aient été extirpés puis réintroduits offre une occasion unique aux chercheurs de comprendre les relations entre les prédateurs et leurs proies. On peut vraiment voir et saisir l'ampleur de la cascade d'effets de leur présence dans environnement
, précise Erin Foster.
« L'écosystème est complètement différent, qu'il y ait des loutres de mer ou pas. »
L'impact le plus visible de la présence des loutres s'est observé sur la population d'oursins. Les loutres de mer apprécient cet invertébré, donc leur réintroduction a limité les populations d'oursins. Cela a ainsi favorisé le développement des forêts de varech, car les oursins sont prédateurs de ces algues sous-marines.
Ces forêts d'algues permettent aux poissons de se protéger et de se reproduire. Le varech permet aussi de réduire la force des vagues, ce qui a un impact sur l'érosion des côtes. Des études démontrent maintenant que les forêts de varech sont d'importants puits de carbone
, poursuit la biologiste Foster. Le retour en grand nombre des loutres a donc eu un effet de cascade sur l'écosystème : plus de loutres, cela signifie moins d'oursins et ainsi plus de forêt de varech.
Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont également remarqué que les loutres peuvent exercer le même effet de cascade dans les habitats de zostères, ces longues herbes aquatiques que l'on trouve près des côtes. Les loutres mangent les crabes, qui sont les principaux prédateurs des escargots et des limaces. Ces invertébrés nettoient les épiphytes, des microalgues qui poussent au-dessus des zostères.
Ce nettoyage favorise la photosynthèse des herbes marines, donc une meilleure reproduction. La présence de ces herbes a un effet positif sur la qualité du milieu aquatique, car elles filtrent les sédiments dans de nombreux estuaires. Et comme les forêts de varech, la zostère a un effet sur la force des vagues. Encore ici, le lien de cause à effet est on ne peut plus clair : s'il y a moins de crabes, il y aura plus de zostère. Il y a environ six fois plus de biomasse de zostère marine dans les zones où il y a des loutres de mer que dans les zones où il n'y en a pas
, précise Erin Foster.

Un retour qui inquiète Un retour qui inquiète
Pour se nourrir, la loutre de mer peut consommer l'équivalent du tiers de sa masse corporelle par jour, soit environ 15 kg de nourriture. Oursins, crabes, palourdes ou autres mollusques, il est évident que l'animal a un impact sur l'abondance des ressources, qu'elle doit partager avec l'humain.
La réussite de la réintroduction de la loutre de mer et son impact sur l'écosystème ne font donc pas que des heureux. Mon grand-père récoltait les fruits de mer pour nous tous. Il y en avait toujours assez et pour tout le monde! Pas de problème! Et aujourd'hui, il n'y a plus rien
, raconte Francis Gillett, le chef héréditaire de la communauté de Kyuquot-Checleset, au nord-ouest de l'île de Vancouver.
C'est tout près de ce petit village des Premières Nations, il y a 50 ans, que les premières loutres ont été réintroduites. Il n'y avait pas d'appareils radio ni d'autres trucs comme ça ici à la fin des années 1960, quand ils ont introduit les loutres, se rappelle le chef Gillett. Nous ne savions même pas ce qu'il se passait jusqu'à ce que ce soit fait.
La communauté de Kyuquot-Checleset participe aussi à un recensement des populations de loutres. Elle concentre ses recherches près de Kyuquot. À l'aide d'un drone, l'équipe évalue le nombre d'animaux dans le secteur. Nous avons compté plus de 600 loutres en une semaine. C'est presque en moyenne une centaine par jour!
, affirme Shawn Hanson, un autre membre de la communauté Kyuquot-Checleset.
Le jeune dans la mi-trentaine souhaiterait que l'on puisse limiter la population de loutres de mer. De cette façon, il pourrait y avoir un retour des autres espèces et donc un meilleur équilibre
, poursuit-il. Pourquoi ne pas en déplacer encore une fois?
, se questionne Francis Gillett, qui réclame un plan de gestion de l'espèce.

Se préparer à l’arrivée des loutres?Se préparer à l’arrivée des loutres?
La question de la présence de loutres résonne partout dans les communautés côtières des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Si certaines personnes de ces communautés voient dans le retour de la loutre une occasion d'affaires pour développer le tourisme à gros prix, la question de l'équilibre des ressources inquiète les régions où la loutre n'a pas encore fait son retour.
C'est le cas des îles Haida Gwaii, au nord-ouest de la Colombie-Britannique, où les résidents se préparent au retour naturel de la loutre, car pour l'instant, le succès de la réintroduction est limité autour de l'île de Vancouver.
Un comité de gestion a été mis en place entre Parcs Canada et la Nation Haida. C'est une première au pays. On veut éviter ce qui s'est produit au large de Kyuquot, où il y a 50 ans aucun membre des Premières Nations n'a été impliqué dans la décision de réintroduire la loutre.
On sait que, d'un point de vue écosystémique, le retour des loutres est une bonne nouvelle
, affirme Lynn Lee, biologiste au parc national Gwaii Haanas, à Haida Gwaii. Mais il faut bien évaluer comment ce retour aura un impact sur nos communautés et comment gérer ce retour. Et ça, on ne peut pas le négliger!
La loutre a été chassée, éradiquée, réintroduite, et maintenant, sa population augmente rapidement. Elle fait désormais partie du paysage, comme avant l'arrivée des Européens, il y a 200 ans.
Ce n'est plus le système qu'on a connu où on a pensé que c'était normal sans les loutres de mer. Maintenant, on voit ce qui est vraiment normal, et c'est à nous de nous adapter
, affirme Andrew Trites, de l'Université de Colombie-Britannique.
« Elles sont un parfait exemple qui prouve que si nous voulons réintroduire des animaux et les protéger, nous pouvons faire ces choix de société. Maintenant, il faut faire face à nos propres besoins. Et là, c'est la complexité du prochain chapitre! »
Le reportage de Benoît Livernoche est diffusé à l'émission La semaine verte le samedi à 17 h et le dimanche à 12 h 30 sur ICI TÉLÉ. À ICI RDI, ce sera le dimanche à 20 h.
Un document réalisé par Radio-Canada Info